Échecs et Truffes 2026 approche à grands pas !!!
Les superstitions des joueurs d’échecs : entre rituels et psychologie
Dans l’univers millimétré des 64 cases, où chaque coup doit être calculé, anticipé, pesé, il serait logique d’imaginer des joueurs totalement imperméables à l’irrationnel. Et pourtant… Même les esprits les plus cartésiens ont parfois leurs petits secrets.
UNIVERS DES ÉCHECS
6/1/20252 min temps de lecture


Les superstitions des joueurs d’échecs : entre rituels et psychologie
Dans l’univers millimétré des 64 cases, où chaque coup doit être calculé, anticipé, pesé, il serait logique d’imaginer des joueurs totalement imperméables à l’irrationnel. Et pourtant… Même les esprits les plus cartésiens ont parfois leurs petits secrets. Comme dans bien d’autres disciplines, les superstitions s’invitent autour de l’échiquier. Elles se glissent dans la poche d’un pantalon, dans un geste répété sans y penser, ou dans le choix d’un stylo fétiche.
🎲 Objets porte-bonheur et routines immuables
Chez certains joueurs, la préparation ne se limite pas à l’étude des ouvertures. Il y a ce joueur qui n’attaque jamais sans sa montre posée à droite du plateau — jamais à gauche. Un autre qui porte invariablement la même chemise lors des compétitions, comme si le tissu portait en lui la mémoire des victoires passées. Une jeune joueuse vérifie trois fois l’alignement de ses pièces avant chaque partie, créant une armure invisible tissée de petits gestes 🧵.
Ces routines, bien qu’inutiles d’un point de vue technique, permettent au joueur de se sentir dans un cadre connu. Un peu comme un acteur qui répète ses mouvements avant de monter sur scène. En psychologie, on parle d’ancrages : des habitudes qui, par leur simple répétition, activent un état d’esprit favorable à la performance.
🧠 Le pouvoir invisible du rituel
Il suffit d’observer un tournoi pour constater la fréquence de ces rituels. L’un souffle sur ses mains avant chaque coup d’ouverture. Un autre tapote deux fois sa pendule après chaque mouvement. À première vue, ces comportements peuvent sembler anodins, voire absurdes. Mais ils servent une fonction essentielle : marquer la transition entre le quotidien et le moment de jeu.
C’est comme une porte coulissante vers la concentration 🚪. Le monde extérieur s’efface. Le temps se ralentit. L’échiquier devient le seul univers valable. Ces rituels ne sont pas enseignés, mais souvent observés, imités, reproduits. Voir un maître international répéter les mêmes gestes donne à ces habitudes une aura silencieuse de sagesse.
📉 Quand la superstition devient un piège
Mais l’humain est parfois victime de ses propres automatismes. Certains joueurs attribuent une défaite à un oubli de rituel : un t-shirt lavé par erreur, une pièce mal orientée, un stylo remplacé. Ce n’est plus la stratégie qui fait foi, mais une croyance : celle que la victoire dépend de quelque chose d’externe, voire de magique.
Ces excès peuvent être contre-productifs. Au lieu d’aider, le rituel devient une contrainte. Une source d’angoisse en cas d’oubli. Il est donc crucial d’apprendre à identifier ce qui relève d’un simple geste rassurant — et ce qui devient une béquille mentale, voire un frein à la performance.
✨ Entre irrationalité et maîtrise de soi
Au fond, les superstitions dans les échecs ne sont pas une anomalie. Elles sont le miroir d’une vérité plus large : nous ne sommes pas que des cerveaux logiques. Nous sommes faits de doutes, de sensations, d’histoires personnelles. Et si une montre posée à droite ou une chemise porte-bonheur aide à jouer mieux — ou à jouer plus serein — alors pourquoi s’en priver ?
Comprendre ces comportements, ce n’est pas s’en moquer. C’est reconnaître que derrière chaque pion avancé, chaque cavalier déplacé, il y a un joueur en quête de repères. Et peut-être qu’en rangeant son stylo trois fois avant de jouer, il dit simplement : je suis prêt.
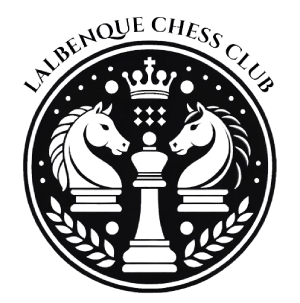
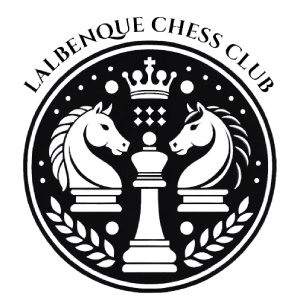
Salle de la Halle
Rue de la Mairie - 46230 Lalbenque
Le mercredi
Enfants - 17h30 à 18h30
Adultes - 18h30 à 20h30
Photos non contractuelles
Conditions générales d'utilisation
